[podcast] Covid-19 : du doute à la défiance
Origine du virus, utilité du masque, intérêt de l’hydroxychloroquine et aujourd’hui stratégie vaccinale : durant cette crise sanitaire des avis divergents n’ont cessé d’être émis, discutés, médiatisés. Un imbroglio non sans conséquence sur lequel revenaient, le 7 janvier, les Rencards du Savoir.

- 25/01/2021
 © Franzi draws - istock
© Franzi draws - istock
« Nous ne combattons pas seulement une pandémie, nous combattons aussi une infodémie. » Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS (l’Organisation mondiale pour la santé), s’exprimait déjà ainsi en février 2020. L’infodémie ? C’est cette avalanche d’informations sur la Covid19, véridiques ou fausses, qui nous submerge au quotidien. Difficile alors de bien saisir tous les enjeux de la crise sanitaire, de savoir qui croire, de ne pas ressentir de la méfiance envers le gouvernement, les autorités de santé, les scientifiques…
S’intéresser à la relation de confiance entre les citoyens et les acteurs garants de leur santé, c’est non seulement parler de recherche, de médecine, de politique sanitaire mais aussi de journalisme et de communication à tous les niveaux. Un vrai sac de nœuds que les Rencards du Savoir proposaient de démêler, le 7 janvier dernier, lors d’un café débat numérique. Étaient présents Estelle Dumas-Mallet, postdoctorante en sciences de la communication à l’Institut des Maladies Neurodégénératives (IMN - CNRS et université de Bordeaux), Louis Rachid Salmi, professeur de santé publique et chercheur au Centre de recherche Bordeaux Population Health (BPH - Inserm et université de Bordeaux) et Cédric Brun*, maître de conférences en philosophie des sciences au laboratoire Sciences, philosophie, humanités (SPH - université Bordeaux Montaigne et université de Bordeaux).
Des sources fiables ?
Selon une estimation**, environ 200 000 articles scientifiques et prépublications (ou preprints : papiers qui n’ont pas encore été évalués par les pairs) auraient été publiés dans le monde entre le début de la pandémie et décembre dernier. Un rythme de publication qui donne le vertige et devrait inviter à s’informer avec, sinon une certaine méfiance, un regard critique. Dans le traitement médiatique de la crise sanitaire, ce dernier semble pourtant manquer parfois à l'appel. « Par contrainte temporelle notamment, mais également parce que les sources à traiter sont très pointues, les journalistes - même spécialisés en sciences - ont tendance à reprendre les informations des communiqués de presse, déjà bien rédigés, et à ne pas faire d'investigation » constate Estelle Dumas-Mallet.
Quand l’expert se perd…
Autre épineux problème souligné par les intervenants : le choix des "experts" auxquels la parole est donnée. Entre le CV, la proximité géographique avec les plateaux TV sans oublier l’appétence ou non pour le direct, les critères sont nombreux (et discutables !). La façon dont ils sont amenés à intervenir sur une question interroge également : proposer d’entendre, pour tout sujet, des voix discordantes est-il vraiment gage de qualité ?
1er [Rencard du Savoir] de l'année avec un #débat très actuel sur le dialogue #société/#santé. Relations complexes, problématique des sources d'information et de la validité des connaissances scientifiques. pic.twitter.com/raNRzWBEfy
— Anne Lassègues (@ALassegues) January 7, 2021
Pour s’y retrouver dans ces controverses parfois plus médiatiques que scientifiques, quelques billes sont données. Cédric Brun met ainsi en garde : s’il faut se méfier de tout argument débutant par l’expression « Je ne suis pas médecin, mais... », la proposition « Je suis médecin et... » n’assure pas plus la validité du propos lorsqu’il est question d’économie, de sciences sociales, de psychologie... « Les enjeux de cette crise sanitaire dépassent de très loin les problématiques de santé et il est nécessaire que chaque expert identifie les limites de son intervention » ajoute-t-il.
L’art de communiquer en santé
Dans ce dialogue entre scientifiques, journalistes, citoyens et décideurs politiques se pose la question de l’expertise des interlocuteurs, mais également celle du moment et du lieu des échanges. Ainsi, si associer les populations aux prises de décision apparaît primordial, il s’agit de le faire tôt, avant que la confiance entre les acteurs ne s'étiole !
Une fois des mesures sanitaires actées, il est par ailleurs important d'avoir un discours uniforme tout en adaptant la communication aux spécificités des populations et des territoires. Comment ? « En s’appuyant notamment sur des médiateurs socioculturels : des personnes, issues d’une population ciblée, qui connaissent les facteurs pouvant faciliter l'adoption des mesures sanitaires par les membres de celle-ci » explique Louis-Rachid Salmi.
Autre aspect à ne pas négliger : les représentations dans notre société de la médecine et les attentes qui en découlent. Comme l'explique Cédric Brun, « c'est notamment l'idée que, s'il existe une maladie, il doit y avoir un traitement en regard. Dans un contexte où il est simplement conseillé de prendre du paracétamol et de s'isoler, si un chercheur revendique avoir trouvé une molécule permettant de guérir de la Covid-19 il est alors très difficile de contredire sa découverte via des arguments probants tels des travaux scientifiques ». Rien ne doit être omis pour améliorer la communication dans cette crise sanitaire et si les intervenants soulignent les écueils rencontrés, ils donnent également de nombreuses pistes pour les contourner, à (re)découvrir en podcast.
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
*actuellement en délégation CNRS à l'Institut des maladies neurodégénératives (IMN, CNRS et université de Bordeaux)
**https://www.nature.com/articles/d41586-020-03564-y qui présente une estimation réalisée à partir de la base de données Dimensions.
Les Rencards du savoir
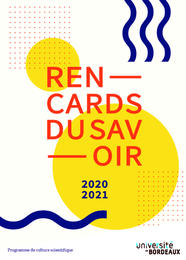
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir en ligne

"Aux vents mauvais, les éco-réfugiés" le jeudi 28 janvier à 18h30











