[podcast] Écrin de verdure, où te loges-tu ?
Agricole, végétale, résiliente : c’est une ville aux natures diverses que pensent les acteurs aménageant le territoire. Le café-débat des Rencards du savoir du 6 mai dernier s’intéressait à la place occupée par la faune et la flore dans les projets d’urbanisme et aux moyens variés de la valoriser.

- 26/05/2021
 Le complexe architectural Bosco Verticale à Milan par Stefano Boeri © Thomas Ledl (wiki)
Le complexe architectural Bosco Verticale à Milan par Stefano Boeri © Thomas Ledl (wiki)
En Gironde, le taux d’artificialisation des terres, c’est-à-dire l’emprise de l’urbanisation sur les sols naturels et agricoles, a augmenté de 17,1 % entre 2007 et 2014*. Il suit une dynamique nationale que le gouvernement souhaite enrayer avec « zéro artificialisation nette » en 2030. En 2018 toutefois, ce sont encore 23 907 hectares (la superficie de la ville de Marseille) qui ont été artificialisées (chiffres du CEREMA). Face à l’étalement urbain, quelle place pour la nature ?
Dans et hors la ville, les réponses formulées sont nombreuses. Le café-débat des Rencards du savoir du 6 mai proposait de les explorer aux côtés de Catherine André, responsable du Master 1 Paysage, évaluation environnementale et projets de territoires de l'institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme (IATU - université Bordeaux Montaigne), Mayté Banzo, enseignante-chercheuse en géographie au laboratoire Passages (CNRS, Ensap Bordeaux, université Bordeaux Montaigne, université de Bordeaux, UPPA) et Gérard Thomas, praticien et chercheur en urbanisme, chargé de mission stratégie urbaine à la ville de Floirac.
De multiples services recherchés
Penser la nature en ville, c’est d’abord faire face à un problème sémantique : qu’est-ce que l’on entend par la « nature » ? « Il n’y en a pas une seule, mais autant que d’acteurs la concevant et aménageant le territoire. Urbanistes, paysagistes, biologistes, conseillers de chambre d’agriculture... : chacun cherche à répondre à des objectifs très différents - notamment de biodiversité, climatiques ou alimentaires - qui peuvent s’accorder... ou non ! » répond Mayté Banzo. Le parc des Jalles, au nord-ouest de Bordeaux, voit par exemple sur sa large superficie, des usages récréatifs et écologiques entrer parfois en compétition avec les usages agricoles.
Repenser l'équilibre entre ville & nature. Initiative réjouissante de jardins aux stations de métro londonien. Rdv le 6/05 pour le #cafédébat sur la place et l'intérêt des espaces verts urbains sur YouTube @univbordeauxhttps://t.co/v5D6i7yHX5
— Anne Lassègues (@ALassegues) May 4, 2021
« L'agriculture urbaine », voilà une autre expression polysémique ! Jardins privés ou partagés, fermes et microfermes, aquaculture, élevages pédagogiques... : les formes sont variées, tout comme les enjeux. À l'idée, parfois utopiste, d'une ville nourricière, prévalent des objectifs sanitaires (bien manger, jardiner...), environnementaux (manger local et bio), sociaux, éducatifs. « Dans le tissu urbain et périurbain, toutes les formes d’agriculture qui se développent, qu’elles soient entrepreneuriales, de loisir ou vivrières, partagent même une visée encore plus profonde : reconnecter les établissements humains, l’homme, à la nature. Chose que l’on a un peu oubliée dans la ville moderne. » constate Gérard Thomas.
Ère du minéral et renaturation
Reverdir la ville, une dynamique novatrice ? « Dans l’aménagement, la protection des espaces non bâtis existe depuis longtemps, qu’ils soient agricoles ou non » rappelle Mayté Banzo. Mais les enjeux ont évolué : « il y a encore quelques années, par exemple, les zones humides ne bénéficiaient pas de la place qu’elles ont aujourd’hui dans les plans d’urbanisation » note-t-elle. « C’est notamment leur fonction écologique « d’éponge » naturelle qui, face au risque inondation, apparaît aujourd’hui cruciale » ajoute Catherine André. Le marais de Brouage, en Charente-Maritime, en est un bon exemple, et fait l’objet d’une gestion concertée par les villes environnantes.
La nature est également de plus en plus souvent pensée en termes d’écosystèmes fonctionnels. Si une micro-forêt comme celle de la placette Billaudel à Bordeaux peut jouer le rôle d’îlot de fraîcheur, abaissant la température en été dans les rues adjacentes, ses cent mètres carrés constitueront difficilement un écosystème à part entière ! En revanche, si la micro-forêt est intégrée dans un réseau d’espaces naturels, la biodiversité pourra se l’approprier. À Milan par exemple, les fameux immeubles Bosco Verticale, présentant des façades arborées, s’intègrent à un large projet de forêt urbaine.
Une biodiversité triée sur le volet
Si (ré)inviter la nature en ville sonne comme une évidence, les urbanistes et paysagistes doivent composer avec des contraintes qui ne sont pas uniquement spatiales, matérielles, environnementales ou financières. « La nature est aussi pensée en termes de qualité de cadre de vie et, en ce sens, la biodiversité en ville est une biodiversité choisie. Les rats et les moustiques, par exemple, n'y sont pas les bienvenus ! Les plantes quant à elles doivent répondre à des exigences esthétiques, ne pas être trop rugueuses, piquantes... Une strate végétale trop haute risquera également d'entraîner par endroits un sentiment d’insécurité la nuit. Autant d'aspects à ne pas négliger » souligne Catherine André.
S’il s’agit de prendre en compte besoins et envies des citadins il ne faut pas oublier que ceux-ci sont aussi des acteurs. Comment chacun peut-il apporter sa fleur à l’édifice ? Du jardinage sur son balcon au locavorisme, en passant par le simple fait d’éveiller sa curiosité, les intervenants ont donné différentes pistes, à (re)découvrir en podcast.
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
*Donnée de 2018 de l’Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine citée dans le rapport Ecobiose.
Les Rencards du savoir
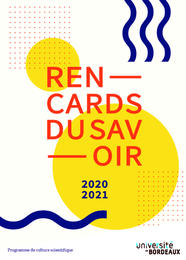
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir

"Homo sapiens : (r)évolution cognitive ?" le mardi 15 juin à 18h au Musée d'Aquitaine (sur inscription).











