[podcast] Homo sapiens, plus futé que ses ancêtres ?
Néandertal le rustre, Cro-Magnon le malin ? En voilà une idée ! Les données archéologiques abondent aujourd’hui pour redorer le blason des nombreux représentants de la lignée humaine. Mais comment expliquer leurs éclats de génie ? Le 15 juin 2021, les Rencards du savoir investiguaient la question.

- 22/06/2021
 Comparaison de crânes d'humain moderne (gauche) et de Néandertalien du Musée d'histoire naturelle de Cleveland © hairymuseummatt - Wikimedia
Comparaison de crânes d'humain moderne (gauche) et de Néandertalien du Musée d'histoire naturelle de Cleveland © hairymuseummatt - Wikimedia
Il y a deux ans était découvert Homo luzonensis, une nouvelle espèce d’homme préhistorique ou, dit plus scientifiquement, d’hominine. Nouvelle branche d’une lignée humain déjà buissonnante, elle aurait été contemporaine de plusieurs autres représentants du genre Homo - dont notre espèce, Homo sapiens. L’histoire évolutive des hominines apparaît décidément bien enchevêtrée… Quand bien même, de ce désordre est né un être aux capacités cognitives remarquables, capable de s’interroger sur ses origines. Que s’est-il passé ?
C’était l’une des vertigineuses questions abordées, le 15 juin dernier, lors du dernier café-débat des Rencard du savoir de cette saison au musée d’Aquitaine. Étaient présents l’un des paléoanthropologues ayant participé à la description d’Homo luzonensis, Clément Zanolli, chercheur CNRS au laboratoire PACEA (De la préhistoire à l'actuel : culture, environnement et anthropologie - unité CNRS, ministère de la Culture et université de Bordeaux), Jacques Jaubert, professeur de préhistoire rattaché également à PACEA, spécialiste de Néandertal et des grottes de Bruniquel et Cussac ainsi qu’Étienne Bimbenet, professeur de philosophie contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne, dont les recherches portent notamment sur l’humain. Alors, quelle (r)évolution cognitive nous conte la préhistoire ?
Des crânes peu loquaces
Premier réflexe pour y répondre : s’intéresser aux cerveaux, donc aux crânes. Manque de chance, ceux dont la partie intérieure, l’endocrâne, est bien conservée, ne sont pas monnaie courante. Pire, les archéologues ne disposent pour certaines espèces que de fragments parcellaires (une seule mandibule pour l'Homme de Denisova) voire n’ont aucune partie du crâne, comme pour Homo luzonensis. Clément Zanolli met par ailleurs en garde : « en matière de capacités cognitives, ce n’est pas le volume du cerveau qui est important mais les connexions entre les neurones, un aspect dont les fossiles ne peuvent témoigner. Ce n'est pas, par exemple, parce que le cerveau d'Homo erectus était de plus petite taille que celui d'Homo sapiens, qu'il présentait nécessairement moins de connexions neuronales ou que ces dernières étaient moins performantes ! »
Clap de fin pour les Rencards du savoir 2020-2021 de @univbordeaux au @MuseeAquitaine Bravo à @CultureUnivBx@ALassegues et Yoann Frontout pour la programmation et rdz-vous en octobre pour la prochaine saison ! pic.twitter.com/RZaUWQXP1F
— Université de Bordeaux (@univbordeaux) June 15, 2021
Comme le rappelle le chercheur, l’aire de Broca, associée au langage, apparaît d'ailleurs assez développée chez cette espèce. Mais il invite à ne pas s'arrêter aux seules dispositions cérébrales apparentes et à considérer les acquisitions culturelles. La maîtrise du feu, les outils de pierre taillée ou encore l'étrange coquillage de Trinil, gravé de quelques lignes géométriques, ne témoignent-ils pas de la créativité de ce lointain ancêtre ?
Questionner les vestiges du passé
Pour apprécier l’évolution de la cognition chez les hominines, il faudrait donc se pencher sur leurs créations. Qui a confectionné le premier outil en pierre ? Qui a, pour la première fois, investi le milieu souterrain ? « Il est étonnant de voir la similitude chronologique des productions techniques comme symboliques réalisées par les hominines » s’enthousiasme Jacques Jaubert. S'il y a eu des échanges entre les groupes sociaux et les espèces, notamment entre Homo neanderthalensis et Homo sapiens, ces interactions n'expliquent pas tout... « Par exemple, en Europe comme en Indonésie, c'est à seulement quelques milliers d’années près que les grottes et les abris ont été investis et que l'on a commencé à y représenter le monde. C'est-à-dire, à l'échelle des temps géologiques, presque au même moment. Comme si, que l’on soit sur l’île de Sulawesi ou en Ardèche, le temps de peindre était arrivé » observe le préhistorien. Mais comment l’expliquer ?
Ces inventions qui font l’homme
Avec le principe de coévolution gène - culture (ou nature - culture), Étienne Bimbenet apporte un élément de réponse. Par la sélection naturelle, Charles Darwin expliquait l’un des moteurs de l’évolution du vivant : ce sont les individus les mieux adaptés à leur milieu qui détiennent le plus de chances de se reproduire, l’environnement exerçant donc une pression sélective. Mais on peut envisager les choses un peu différemment. « Le milieu fait le vivant mais le vivant fabrique également son milieu : une boucle causale apparaît » souligne le philosophe. Le monde est à la fois fabriqué et fabriquant : « le feu est maîtrisé, puis la cuisson des aliments se développe, celle-ci permettant au fil du temps un élargissement du cerveau, ce dernier bénéficiant d’un apport énergétique plus important. Mais c’est aussi vrai pour le langage : les proto-humains créent quelques mots, les meilleurs êtres parlants s’adaptent, produisent un meilleur langage qui sélectionnera à nouveau les meilleurs orateurs et ainsi de suite. Ce processus est crucial, car il nous permet de comprendre que l’histoire de l’hominisation ait pu connaître de grandes accélérations, et ainsi de véritables effets de seuil » conclut-t-il.
Reste, néanmoins, bien des questions. Quels seuils cognitifs Homo sapiens aurait-il été le seul à franchir ? Pourquoi est-il aujourd’hui l’unique représentant du genre Homo ? En interrogeant les racines de l’Homme moderne, les intervenants lui tendaient, dans le même temps, un miroir. De l’être pédagogue à l’espèce invasive, notre portrait est à retrouver en podcast.
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
Les Rencards du savoir
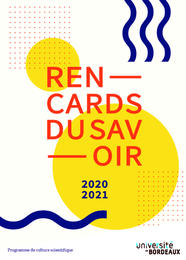
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.











