[podcast] Insaisissables mouvements sociaux
Mettre de côté les points de vue « à chaud », passionnés et partiaux, pour proposer des analyses à la fois sociologiques, historiques et artistiques d’un objet de recherche pour le moins original : c’est ce que proposaient, le 17 décembre, les Rencards du savoir en abordant les mouvements sociaux.

- 15/01/2021
 Des suffragettes anglaises manifestent devant le tribunal de police en 1911 © wikicommons
Des suffragettes anglaises manifestent devant le tribunal de police en 1911 © wikicommons
À la mention de conflits ou mouvements sociaux, les images affluent et il semble facile d’en proposer une définition. Des regroupements de militants orientés à gauche de l’échiquier politique ? Non : la droite, elle aussi, peut descendre dans la rue, comme lors des manifestations du collectif La Manif pour tous. Des rassemblements s’opposant à un projet ou une action de l’État ? Non plus : « Je suis Charlie », par exemple, a été un mouvement social prônant, avant tout, la liberté d’expression. Le dénominateur commun de ces rassemblements serait-il alors à chercher dans leur occupation de la rue ? Certainement pas : les moyens d’expression sont bien plus variés. Au Japon, par exemple, on exprime son mécontentement en portant, tout en travaillant, un brassard.
Pour balayer les idées reçues sur les mouvements sociaux et mieux comprendre ces derniers, les Rencards du Savoir proposaient le 17 décembre dernier un café-débat numérique. Camille Bedock, chargée de recherche en sociologie au Centre Émile Durkheim (université de Bordeaux et Science Po Bordeaux), Nicolas Nouhaud, doctorant en arts au laboratoire MICA (Médiations, informations, communication, arts – université Bordeaux Montaigne) et Nicolas Patin, maître de conférences en histoire à l’université Bordeaux Montaigne y ont croisé savoirs académiques et anecdotes éloquentes.
Des formes en mouvement
Rassemblements de Nuit debout, grèves massives de 1995, contestations du Printemps arabe ou encore révoltes paysannes avec déguisements, comme en 1774 à Saint-Just-d’Avray où les autorités eurent affaire à des fées... La figure du conflit social se révèle polymorphe ! Le sociologue Erik Neveu parle de manière synthétique de « formes d’action collective concertée en faveur d’une cause. » Il ne faudrait toutefois pas voir dans cette définition l’idée d’un regroupement homogène d’individus. Comme le rappelle Camille Bedock, un mouvement social rassemble des personnes aux motivations différentes, aspect particulièrement visible chez les Gilets jaunes où la vision de la démocratie des participants se fait multiple et s'avère bien moins radicale que les médias ne l’ont présentée.
Les façons de se mobiliser et de s’exprimer sont tout aussi diverses. Que ce soit à travers des radios pirates, comme Lorraine Cœur d’Acier, ou plus récemment les réseaux sociaux et les rassemblements sur les ronds-points, la parole se libère. « Une des grandes nouveautés permise par les réseaux sociaux est que la voix d’un individu puisse avoir beaucoup de poids dans un conflit social sans qu’elle ne soit portée par des représentants, par exemple des syndicats. Il y a une horizontalité dans la prise de parole, comme l'a montré le mouvement #MeToo ou dernièrement #balancetonbahut pour les restrictions vestimentaires dans les lycées » souligne Camille Bedock.
L’heure des heurts
Cette prise de parole se manifeste notamment par des émanations artistiques. « Qu'elles proviennent des acteurs d'un mouvement social, de la police ou du pouvoir, ces dernières ont de nombreux rôles : elles assurent la communication interne / externe, motivent, galvanisent, intimident, permettent tant d'attaquer que de se défendre... » énumère Nicolas Nouhaud. Des caricatures graveleuses de Marie-Antoinette aux écussons pouvant être arborés par les forces de l’ordre, le panorama est vaste... Sans omettre les arts martiaux, tel le jujitsu employé par les suffragettes au début du XXe siècle pour faire face à la répression policière !
Répression, affrontements, casses : la question de la violence vient conclure le café-débat. Une violence grandissante, comme on peut souvent le lire ? Il s’agit déjà de s’interroger sur ce que l’on entend par ce terme puis de questionner la survenue des « débordements » ainsi que la gestion qui en est faite. « Quand une cause perd l’adhésion de la masse, la violence vient compenser le manque du nombre. Cette théorie sur l’évolution du mouvement social, développée par les sociologues Donattela Della Porta et Isabelle Sommier, s'est vérifiée plusieurs fois dans l'Histoire » explique Nicolas Patin, citant les Brigades rouges, organisation terroriste fondée sur les cendres des contestations sociales en Italie à la fin des années 60. La question est toutefois loin de se résumer à une théorie, tous comme les autres angles abordés dans ce café-débat, à (re)découvrir en podcast.
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
Les Rencards du savoir
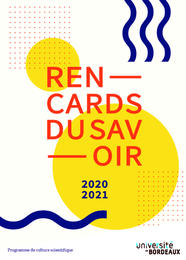
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir en ligne

"Aux vents mauvais, les éco-réfugiés" le jeudi 28 janvier à 18h30











