[podcast] Quand le climat dépossède l’humain de son foyer
Au Bangladesh, sur les îles Carteret, dans le Sahel et ailleurs, le changement climatique contraint des populations à se déplacer. Beaucoup de chiffres et de craintes formulés sur ces écoréfugiés, mais une réalité souvent peu fouillée. Les Rencards du Savoir l’abordaient le 28 janvier dernier.

- 08/02/2021
 Ile du Brahmapoutre au Bangladesh* © Eric Veyssy - Terre & Océan
Ile du Brahmapoutre au Bangladesh* © Eric Veyssy - Terre & Océan
« 1 milliard de réfugiés climatiques d’ici à 2050. » Cette projection, qui ne donne que l’estimation la plus haute formulée par l’ONU en 2008, est reprise à tire-larigot par les médias et les acteurs politiques. À bon comme à mauvais escient : n’annoncerait-elle pas une vague de migrants, prête à s’abattre, dans une poignée d’années, sur les pays encore émergés ?
Loin des clichés venant à l’esprit lorsqu’il est question de migrations et de changement climatique, les enjeux humains posés par les sécheresses, inondations, tempêtes, feux de forêt et dégradations progressives des écosystèmes sont complexes à appréhender. Derrière les aspects démographiques, écologiques et politiques, se posent des questions relatives au droit, à la sociologie, à la santé… Le café-débat des Rencards du Savoir du 28 janvier faisait s’entrecroiser les regards de trois intervenants sur le sujet : Émilie Chevalier, enseignante de lycée en histoire-géographie à Valence d'Agen, Anne-Marie Tournepiche, professeur de droit public à l’université de Bordeaux** et Eric Veyssy, directeur de l’association Terre & Océan.
L’écoréfugié, migrant invisibilisé
« Derrière les estimations chiffrées, il y a les critères choisis pour les calculer, rappelle Émilie Chevalier. À commencer par la terminologie employée : qu’entend-on par “réfugié climatique” ? Difficile à dire, mais en tout cas pas un réfugié ! Comme le rappelle Anne-Marie Tournepiche, ce terme a déjà une définition bien précise, liée à une crainte de persécution. Il ne prend donc pas en compte les facteurs climatiques pouvant pousser des personnes à quitter leur lieu de vie.
« À l’heure actuelle, il n’existe d’ailleurs aucun statut spécifique protégeant ces personnes. Il n'y a pas davantage de consensus entre l'ensemble des états pour élaborer et mettre en place une convention qui leur imposerait des obligations en matière d'accueil des déplacés climatiques » ajoute-t-elle. La prise en compte du facteur climatique se fait alors au cas par cas, à travers la jurisprudence. Le 18 décembre dernier par exemple, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, pour la première fois, pris en considération le critère climatique pour justifier la reconnaissance du statut d'étranger malade à un ressortissant Bangladais.
Partir… Où ? Comment ? Combien de temps ?
Les formes de déplacements liés au climat se révèlent très diverses, à commencer par leurs durées. Toutes ne sont en effet pas définitives, comme le précise Émilie Chevalier : « cela va de l’évacuation d’une zone pour quelques heures, jours, semaines à des allers-retours saisonniers voire sur quelques années. Au Pérou par exemple, le chef de famille part souvent travailler à la capitale durant les épisodes El Niño puis revient afin de ne pas perdre ses droits de propriété sur ses terres. » Le phénomène océanique El Niño entraîne en effet de nombreux bouleversements sur la côte Est du Pacifique, de la diminution des stocks de poissons à la formation de violentes tempêtes.
La distance parcourue est elle aussi très variable, mais les déplacements se font souvent au sein d'un même pays. « La première démarche pour ceux qui sont directement percutés par le problème climatique n’est pas d’aller en Europe » insiste Eric Veyssy. La plupart sont des ruraux qui n'ont pas les moyens de réaliser une telle migration : s’ils partent, ils le font en premier lieu dans une ville proche. Mais au Bangladesh par exemple, où Eric Veyssy a recueilli de nombreux témoignages, la plupart n’y songent même pas : bien que les risques de crues augmentent, « ils ont un attachement très fort pour leurs terres et expliquent qu’ils y resteront, quitte à être emportés par le fleuve ».
À la pression exercée par le climat s’ajoute ainsi des questions d’opportunité d’emploi, d’éducation, de culture, de vécu quand il est question de quitter ou non son foyer. Quant aux réponses apportées, les intervenants évoquent tant les projets de réinstallation que la spéculation foncière ou encore les aménagements pour se maintenir sur place. Des aspects que le podcast propose de (re)explorer en partant à l’autre bout du monde mais aussi dans des endroits familiers… comme en Gironde !
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
* Cette photo a été prise au Bangladesh (île du Brahmapoutre), au niveau des "chars", îles qui apparaissent puis disparaissent... On y voit la reconstruction d'une maison au centre de l'île du Brahmapoutre. Eric Veyssy précise que cette photo illustre une phrase prononcée par certains habitants : "on vit comme les oiseaux !"
**rattachée au Centre de recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) et vice-présidente Vie étudiante et vie de campus de l'université
Les Rencards du savoir
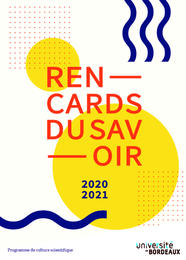
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir en ligne

Perturbateurs endocriniens, des mélanges qui dérangent, le mercredi 24 février à 18h











