[podcast] Sans mot dire, le vivant va, et s’en va
Elle fait moins les gros titres que le changement climatique mais est tout aussi préoccupante : la crise de la biodiversité continue de s’amplifier, dans un silence bien trop bruyant. Les Rencards du savoir proposaient de prendre le pouls du vivant et d’examiner les solutions pour panser ses maux.

- 15/03/2021
 Les moineaux font partie des espèces qui disparaissent depuis quelques années © Susanne Jutzeler/pixabay
Les moineaux font partie des espèces qui disparaissent depuis quelques années © Susanne Jutzeler/pixabay
32% des oiseaux nichant sur le territoire, 24 % des reptiles, 23 % des amphibiens, 19 % des poissons d’eau douce… Ces chiffres, ce sont quelques-unes des estimations d’espèces menacées en France métropolitaine selon le bilan de la Liste rouge de l’UICN* publié le 3 mars dernier. Derrière les quelques cas iconiques d’animaux disparus – du dodo au dernier rhinocéros mâle blanc du Nord – se cachent, en maints endroits du globe, une faune et une flore en péril, parfois bien plus familière qu’on ne le pense.
Pour mieux comprendre cette crise du vivant, le café-débat des Rencards du Savoir du 4 mars faisait s’entrecroiser les approches de quatre scientifiques en invitant Emmanuelle Augeraud-Véron, enseignante-chercheure à l'université de Bordeaux en économie de l’environnement au Groupe de recherche en économie théorique et appliquée (Gretha - CNRS et université de Bordeaux), Frédéric Barraquand, chercheur CNRS en écologie à l'Institut de mathématiques de Bordeaux (IMB - CNRS, Bordeaux INP et université de Bordeaux), Benoît Sautour, enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux en écologie au laboratoire Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (EPOC - CNRS, EPHE et université de Bordeaux) et enfin Gilles Bœuf, biologiste et ancien président du Muséum national d’histoire naturelle.
Pas une érosion, un effondrement
« Nous assistons à un effondrement du nombre d’individus dans les populations naturelles » décrit en premier lieu Gilles Bœuf. Ce n’est pas encore une extinction de masse, mais le taux d'extinction d'espèces à l'heure actuelle semble nous y amener dangereusement, à un rythme effréné proche de ceux qui ont abouti aux grandes extinctions du passé. D’aucuns pourraient objecter qu’après la disparition des dinosaures, par exemple, d’autres espèces ont repeuplé la Terre. Vrai, « en quelques millions d'années pour que le niveau de biodiversité soit comparable ! » souligne Benoît Sautour. « La question à se poser est donc celle de l’environnement dans lequel nous souhaitons voire évoluer l’espèce humaine, à court comme à moyen terme. »
On fait le point demain 4 mars 18h30 sur ce sujet avec le Rencard du Savoir #cafédébat sur le déclin des espèces en ligne sur YouTube @univbordeaux
— Anne Lassègues (@ALassegues) March 3, 2021
https://t.co/VSXPyQ56N9 avec notamment Gilles Boeuf @Le_Museum et des https://t.co/ZDD6LCh0Em@univbordeauxhttps://t.co/IPm8j1gE4S
La cause de cet effondrement du vivant ? Difficile de ne pas penser au réchauffement climatique mais, comme le rappelle Frédéric Barraquand, de nombreux milieux souffrent d'effets plus directs de l'action humaine. Il prend pour exemple l'invasion de la toundra scandinave par le renard roux et le déclin du renard polaire, des phénomènes semblant liés au climat mais se révélant être plus influencés par l'élevage du renne, qui favorise la survie du renard roux au détriment de son cousin local. Comme l’explique le chercheur, même si le changement climatique est l'une des cinq grandes causes de la crise de la biodiversité, « les deux premières sont, à l'heure actuelle, la destruction des habitats, particulièrement visible en milieu terrestre et la surexploitation des écosystèmes, très importante en milieu marin. »
Peut-on encore agir ?
Causes, conséquences mais aussi leviers d’actions sont discutés. S’il est question de réserves naturelles et de réintroductions d’espèces, la façon même de penser les relations entre l’homme et la nature est abordée, à travers notamment les services écosystémiques : les services rendus par la nature à nos sociétés. « Ce qui est très important à considérer, par ailleurs, c'est la façon dont l'être humain perçoit le risque, particulièrement sur le long terme » souligne Emmanuelle Augeraud-Véron. Pour améliorer cette perception et les prises de décisions qui en découlent, les actions de communication doivent être adaptées. « Il s'agirait par exemple de privilégier l'information locale plutôt que de saturer les médias d'informations plus globales » explique-t-elle.
Pour préserver les écosystèmes, c’est également sur le capital sympathie qu’ont certaines espèces auprès de l’homme qu’il faut jouer. « Sur l’estuaire de la Gironde, la sauvegarde de l’espèce patrimoniale qu’est l’esturgeon permet de protéger le milieu, explique ainsi Benoît Sautour. L’extraction de granulat y est par exemple interdite, ce qui évite des modifications du lit du fleuve et des berges mais aussi la destruction de la faune benthique, c’est-à-dire les espèces ayant développé un lien fort avec le fond de l’estuaire et dont certaines entrent dans le régime alimentaire du poisson. »
Mais préserver des écosystèmes localement, à une petite échelle, alors que tout autour la vie sauvage bat de l’aile, n’est-ce pas une entreprise veine ? « Non, au contraire : il y a des réserves naturelles, notamment marines, qui marchent superbement bien et qui parviennent même à améliorer la situation écologique des alentours, voire à freiner le changement global ! » répond Gilles Bœuf. Émergent ainsi des messages optimistes parmi les constats plutôt sombres, à ré(écouter) - sans crainte de déprimer - en podcast !
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
*Bilan publié par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et l’Unité mixte de service PatriNat (Patrimoine Naturel) réunissant l’Office français de la biodiversité, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRSCentre national de la recherche scientifique
Les Rencards du savoir
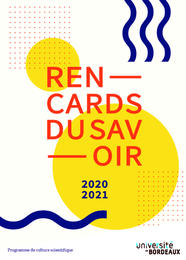
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir en ligne
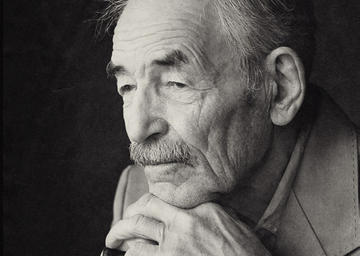
Vivre vieux ou bien vieillir, doit-on choisir ? le mercredi 28 avril à 18h30











