[podcast] Sciences participatives : pour découvrir la recherche, y contribuer
Tout un chacun peut aujourd’hui prêter main-forte aux scientifiques à travers des projets dits participatifs. Les citoyens, simples moissonneurs de données ou potentiels apprentis chercheurs ? Le 2 décembre dernier, les Rencards du savoir se penchaient sur ces façons nouvelles de faire des sciences.

- 03/01/2022
 Fausse chenille placée sur un chêne pédonculé dans le cadre du projet Tree Bodyguards et présentant des traces de coups de bec de prédateurs © Bastien Castagneyrol
Fausse chenille placée sur un chêne pédonculé dans le cadre du projet Tree Bodyguards et présentant des traces de coups de bec de prédateurs © Bastien Castagneyrol
Ah les fêtes de fin d’année : retrouvailles, victuailles… et comptage d’oiseaux ! Depuis 1900, aux États-Unis, ornithologues et grand public se réunissent en cette période autour d’une activité naturaliste : le Christmas Bird Count. Ce recensement massif alimente des bases de données utilisées ensuite par des biologistes. Plus de 300 publications scientifiques ont ainsi été réalisées grâce à ce qui serait le plus ancien programme de sciences participatives. Mais qu’est-ce que signifie exactement « participer » à la recherche scientifique ?
Le 2 décembre 2021, à la Librairie Georges à Talence, un café-débat des Rencards du savoir réunissait pour en parler Raphaëlle Bats, sociologue et coresponsable de l’Urfist* de Bordeaux, Anne Dozières, chargée de mission au Muséum national d’histoire naturelle et directrice de Vigie-nature*, Charles Guttmann, directeur du Centre d’Imagerie neurologique du Brigham and Women's Hospital à Boston et fondateur d’un laboratoire virtuel de neurosciences participatives ainsi que Bastien Castagneyrol, chercheur en écologie au laboratoire Biodiversité, gènes et communautés (Biogeco - INRAE et université de Bordeaux).
Des sciences plus ou moins ouvertes
Si le Christmas Bird Count est un exemple typique de sciences participatives, tous les projets ne reposent pas sur le crowdfunding - littéralement « l’approvisionnement par la foule » - et tous ne s’adressent pas au grand public. Certains rassemblent des petits groupes de professionnels, d’experts, de personnes touchées par une problématique. Raphaëlle Bats, par exemple, a mené un projet autour de la circulation des savoirs mobilisant une dizaine de bibliothécaires. Quant aux initiatives, elles ne sont pas nécessairement issues du monde de la recherche : cela peut être des agriculteurs se rapprochant de chercheurs en agronomie avec une question spécifique ou encore des associations de patients qui interpellent directement des scientifiques. « Dans ce dernier cas, la participation consiste plus à construire la problématique de recherche qu’à collecter des données pour la résoudre. Ce sont des enjeux de témoignages plus que d’expertises : les participants sont d’abord des témoins de ce qui se passe sur leur territoire » souligne Raphaëlle Bats.
Balayer les a priori
Méconnues dans les formes qu'elles peuvent revêtir, les sciences participatives le sont aussi dans leur fonctionnement. Ne seraient-elles pas une façon peu fiable de faire de la recherche à moindre coût ? Anne Dozières bat en brèche cette idée reçue : « il y a eu une certaine crainte que les données récoltées soient trop imprécises, mais nous avons aujourd’hui le recul nécessaire pour attester que la qualité des résultats est au rendez-vous. Par ailleurs, les sciences participatives ne coûtent pas peu cher ! Mais elles sont une autre façon de faire de la recherche, sans laquelle nous ne pourrions pas réaliser certaines études, limités par des contraintes spatiales comme temporelles. »
Bastien Castagneyrol renchérit : « C’est une façon complètement différente de penser les travaux que nous menons. Personnellement, je me rends compte aujourd’hui que c’est autant le résultat en écologie qui m’intéresse que la façon dont la participation peut modifier l’apprentissage des sciences ! » Une visée pédagogique qui soulève deux grandes questions : à quel point des volontaires peuvent-ils s’impliquer dans un processus de recherche ? Et avec quel type de connaissances repartent-ils ?
Découvrir les sciences, découvrir la recherche
Le programme Tree Bodyguards que pilote Bastien Castagneyrol vise à évaluer l’effet du climat sur la résistance des chênes pédonculés aux attaques d’insectes. Partout en Europe, des élèves placent ainsi dans les arbres des chenilles-leurres en pâte à modeler afin d’évaluer l’action de leurs prédateurs. Un prétexte idéal pour enseigner des connaissances en écologie, mais pas seulement. Rares en effet sont les occasions où le grand public peut toucher du doigt la façon dont les connaissances sont produites et discutées. « C’est à mon sens là où les sciences participatives ont un fort potentiel et il demande encore à être exploité » estime le chercheur.
Permettre cette plongée dans les coulisses de la recherche, Charles Guttmann s’y attelle à travers son laboratoire virtuel. Pour former à la méthode scientifique, il a notamment organisé des réunions plénières avec les contributeurs. Objectif : observer à chaud les tendances que décrivent les données récoltées. « Ma grande surprise a été de découvrir avec eux des premiers résultats auxquels je ne m’attendais pas ! » s’enthousiasme-t-il.
Des possibilités offertes par les sciences participatives, les intervenants en viennent à évoquer leurs écueils potentiels : adéquation entre temps long de la recherche et communication des résultats, risque d’instrumentalisation… Pour mieux percevoir les enjeux qui entourent ces programmes scientifiques tout en découvrant comment y prendre part, (re)plongez-vous dans le café-débat… en podcast !
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
* Urfist - Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique
** Programme participatif regroupant plusieurs observatoires de suivi de la biodiversité
Les Rencards du savoir
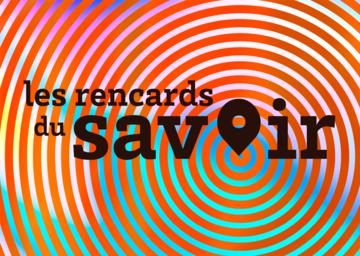
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
(ré)écoutez tous les Rencards du savoir
Retrouvez les podcasts des Rencards du savoir (saison 1 & 2) sur la chaîne Soundcloud et sur toutes les plateformes de streaming habituelles (Deezer, Spotify, Apple podcast...).
Prochain Rencard du savoir : "L’odorat, activateur de mémoire et d’émotions"

Café-débat organisé par le service culture de l’université de Bordeaux, dans le cadre de l'exposition "La Fabrique des innovations, Les coulisses de la recherche en santé" et du programme OLFALAB.











