[podcast] Vieillesse et société : une complicité à (re)trouver ?
Autonome ou dépendante ? Sportive ou grabataire ? La personne âgée est souvent considérée selon une dualité réductrice. Le 28 avril dernier, les Rencards du Savoir invitaient à penser autrement l’avancée en âge et à s’interroger sur des enjeux qui, plus ou moins directement, nous concernent déjà tous.

- 18/05/2021
 © MabelAmber Pixabay
© MabelAmber Pixabay
Selon les chiffres de l’Insee, entre 1950 et 2017, les Françaises et Français ont gagné environ 16 ans d’espérance de vie. Impressionnant, mais la tendance se vérifie-t-elle encore (en omettant ces deux dernières années marquées par l’épidémie de la Covid-19) ? Le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine répond par l’affirmative : « en France, nous vivons de plus en plus longtemps et je suis convaincu que l'espérance de vie ne cessera d'augmenter. Par ailleurs, contrairement aux craintes qui étaient parfois émises, cela est vrai quels que soient les états de santé. Ce sont, autrement dit, tous les temps de la vie qui s'allongent. » Directeur de recherche émérite à l’Inserm et directeur d’études à l’EPHE, Jean-Marie Robine était l’un des intervenants du café-débat des Rencards du Savoir du 28 avril dernier, aux côtés de Muriel Rainfray, professeur de médecine gériatrique à l’université de Bordeaux et Matthieu Sibé, maître de conférences en sciences de gestion à l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED) de l’université de Bordeaux et au Centre de recherche Bordeaux Population Health (BPH, Inserm et université de Bordeaux).
Vieillir, quésaco ?
Du constat posé par Jean-Marie Robine émergent des questions invitant au débat : la société n'aurait-elle pas tendance à considérer les personnes âgées comme un même ensemble d'individus ? L'accompagnement dans le vieillissement est-il adapté à chacune de ces étapes ? Être en "bonne santé" prend-il la même signification lorsqu'il s'agit d'un septuagénaire que d'un centenaire ?... Autant d'aspects qui demandent d'éclaircir un point plus complexe qu'il n'y paraît : quand devient-on "vieux" ?! Muriel Rainfray en souligne la subjectivité : "il y a un continuum tout au long de la vie ; on ne devient pas vieux le jour de ses 65, 70 ou 95 ans. En revanche, les personnes âgées expliquent qu'elles ne se sentent pas vieilles jusqu'au moment où arrive un événement de vie, médical ou non, laissant des marques et les faisant se sentir vulnérables. C’est cette cassure brutale qui marque le début du vieillissement."
Face à cette fragilité, Muriel Rainfray appelle à la prévention puis, lorsqu'une perte d'autonomie s'installe, à un meilleur accompagnement. « En France, tout ce qui recouvre la maladie est reconnu et pris en charge mais pour ce qui est des soins du quotidien, d’aspects minimes et pourtant essentiels, il y a un manque cruel de reconnaissance. Être propre, sentir bon, avoir les cheveux bien coupés, c’est fondamental ! Or si les personnes âgées préfèrent vivre le plus longtemps possible chez elles, leur maintien à domicile est limité par le manque d’aides de ce type à ce jour » constate-t-elle.
Ira ou n’ira pas ?
Lorsque rester à son domicile n’est plus envisageable, se pose la question de l’entrée « en institution » : le départ pour un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Matthieu Sibé déplore à ce sujet un EHPAD-bashing trop systématique qui tend à occulter l’implication du personnel de ces établissements. « S’il y a eu des clusters et des situations dramatiques en EHPAD, la crise sanitaire que nous traversons a aussi montré que les professionnels qui étaient au chevet des personnes âgées ont beaucoup donné. » Il note en revanche des situations de travail difficiles, tant en matière d’horaires que de rémunérations, et plus largement un modèle à revoir. « La stratégie économique d’accompagnement de nos aînés a favorisé la création d’établissements de grande taille, de 80 chambres ou plus, alors que la qualité de vie au travail apparaît bien meilleure dans ceux plus petits » souligne-t-il.
Une question de taille donc, mais aussi de manque de personnel avec une désaffection généralisée pour les métiers du grand âge. « Alors que la demande est forte, nous n'investissons pas assez dans la formation, la qualification et la valorisation de ces métiers » insiste-t-il.
Étoffer les possibilités
Si les intervenants ont exposé les carences du système en place, ils ont également mis l’accent sur des évolutions dans l’accompagnement de l’avancée en âge. En écho au continuum de la vie évoquée par Muriel Rainfray, les formes d’habitats « intermédiaires », entre le domicile et l’EHPAD, se diversifient. En parallèle des résidences autonomie apparaissent des hébergements inclusifs pour seniors, des maisons intergénérationnelles ou encore des initiatives plus spécifiques comme le village Alzheimer qui a ouvert ses portes l’année dernière à Dax.
Derrière l’injection courante aux aînés d’un « bien vieillir » synonyme d’hygiène de vie et d’investissement social, le café-débat invitait à une autre approche : entrevoir comment la société peut répondre au « bien vieillir » formulé par chacun et chacune, en tenant compte de leurs itinéraires de vie comme de leurs espérances quant aux années à venir. Une problématique cruciale à approfondir en se (re)plongeant dans le podcast du café-débat.
Par Yoann Frontout, journaliste scientifique et animateur des Rencards du savoir
Les Rencards du savoir
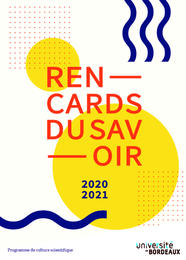
Programmation grand public annuelle constituée de cafés et de cinés-débats en lien avec des sujets d’actualité, les Rencards du savoir permettent à la recherche bordelaise de sortir des laboratoires et des centres de recherche.
Prochain Rencard du savoir en ligne

"Des genres à conjuguer à tous les temps", le vendredi 21 mai à 18h30











